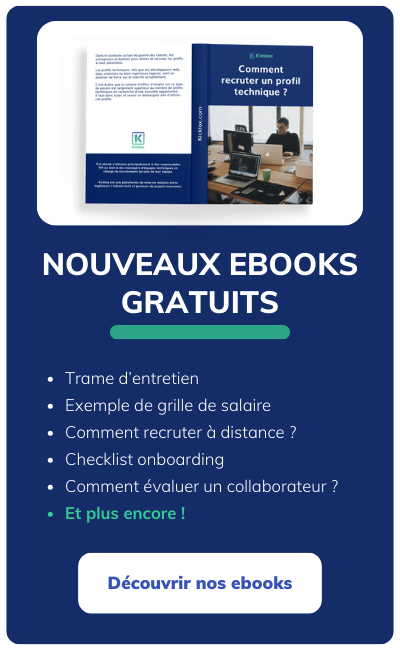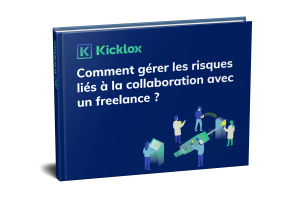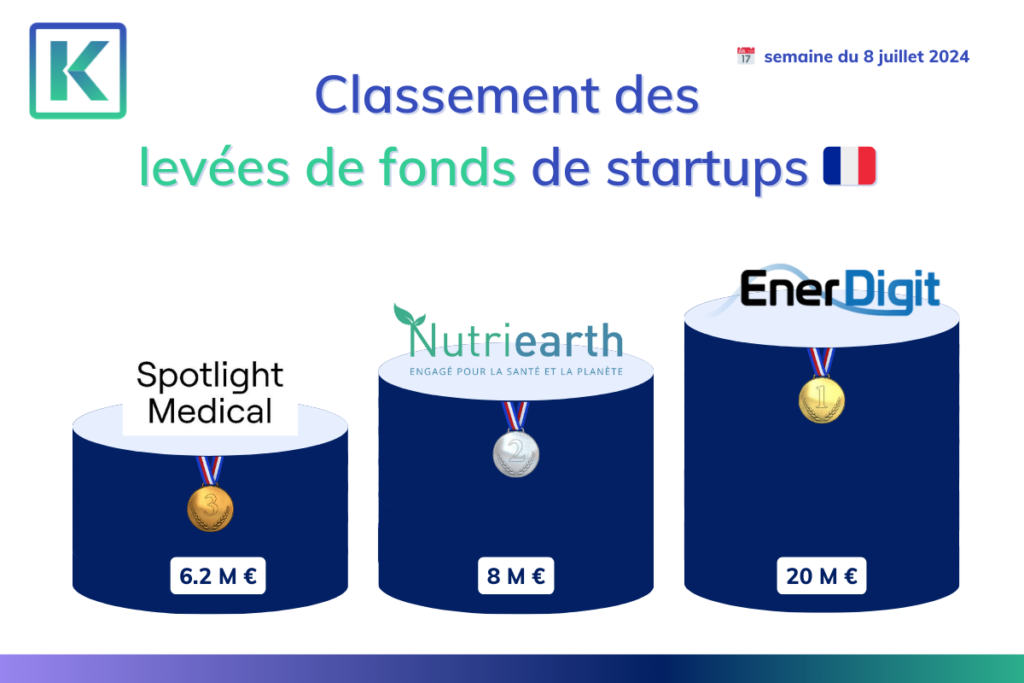Définition du délit de marchandage…
Article L125-1 du code du travail
Selon le code du travail article L125-1 “toute opération à but lucratif de fournitures de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice aux salariés qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou marchandage, est interdite”.
Les associations d’ouvriers qui n’ont pas pour objet l’exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d’entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Le délit de marchandage est le fait pour le salarié d’un prestataire de service de passer de l’autorité de son employeur à celle du client de son employeur, et de subir les conséquences de ce changement d’autorité.
Parfois le délit de marchandage peut être confondu avec la notion de prêt de main-d’oeuvre illicite. Les deux notions sont d’ailleurs tellement voisines l’une de l’autre que le délit de marchandage est très souvent concomitant du prêt de main-d’oeuvre illicite.
Article L8241-1 du code du travail
L’article L 8241-1 du Code du travail définit le prêt de main-d’œuvre illicite comme “Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.”
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
La seule différence avec le délit de marchandage est que le prêt de main-d’œuvre illicite est constitué uniquement lorsqu’il y a une mise à disposition du salarié alors que le délit de marchandage peut être constitué sans fourniture de main-d’œuvre. L’opération de marchandage doit par ailleurs porter un préjudice au salarié, ce qui n’est pas une condition nécessaire pour le prêt de main-d’œuvre illicite.
Ce que dit la loi sur le délit de marchandage…
La loi explique clairement qu’il est interdit à une entreprise de mettre ses salariés à disposition d’une autre entreprise, si elle viole les droits des salariés ou élude la loi dans le but de réaliser un profit.
Pour faire simple, le délit de marchandage est composé de 3 critères :
- Mise à disposition du personnel
- Le personnel procure un gain financier pour l’entreprise
- Le salarié subit un préjudice ou bien, il y a une non-application des dispositions législatives ou conventionnelles.
Ce que dit la jurisprudence sur le délit de marchandage
3 cas pratiques
La jurisprudence permet de donner une indication fiable sur les contextes les plus risqués, et renseigne sur les points de vigilances à adopter afin d’anticiper tout litige. Chaque cas est différents c’est donc pour cela que les juges appliquent les textes de loi au regard des faits.
Ainsi, les juges ont tendance à retenir assez facilement la caractérisation du délit de marchandage dès lors que deux éléments sont réunis :
- Une opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre
A titre d’exemple, lorsqu’une entreprise recourt au prêt de main-d’œuvre afin de contourner volontairement les dispositions légales ou conventionnelles, le délit de marchandage est aisément constitué.
Cette notion de but lucratif est large puisqu’il peut s’agir d’un « bénéfice pécuniaire ou d’économie sur l’embauche des salariés » (Cass. crim., 23 mars 1993, n°98-82.934).
La jurisprudence précise que le “prêt illicite devait entraîner, au profit de l’utilisateur ou du prêteur de main d’œuvre un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire” (Cass. crim., 11 juillet 2017, n°16-86092).
- Caractère exclusif du prêt de main d’œuvre
L’infraction de prêt de main d’œuvre illicite suppose que la mise à disposition de personnel soit exclusive de toute autre prestation, au regard des prestations du prêteur.
Cette exclusivité n’est pas nécessaire pour retenir le délit de marchandage.
- Préjudice causé aux ouvriers
Le délit de marchandage est caractérisé dès l’instant que les salariés mis à disposition n’ont pas perçu les mêmes avantages que les salariés permanents (Cass. crim., 20 oct. 1992, n° 91-86.835).
La jurisprudence reconnaît que des critères complémentaires peuvent caractériser l’infraction : lorsque le client exerce une certaine autorité sur les salariés du prestataire (structure de portage), en donnant des instructions, en approuvant l’embauche du personnel ou en assurant sa formation et en le dirigeant parfois (Cass. crim., 28 janv. 1997, n° 96-80.727 ; Cass. crim., 30 oct. 1995, n° 94-84.807 ; Cass. crim., 3 mai 1994, n° 93-83.104 ; Cass. crim., 22 oct. 1996, n° 96-80.194).
Sanctions
Le délit de marchandage est une infraction à prendre au sérieux même si sa réalisation est parfois involontaire, cependant les sanctions peuvent être très lourdes.
Deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ou 10 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
Interdiction de sous-traiter de la main d’œuvre pour une durée allant de deux à dix ans
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, aux frais de la personne condamnée, dans les conditions fixées par l’article 131-35 du Code pénal (et article L. 8234-1 Code du travail)
Exceptions
La jurisprudence peut accepter le prêt de main d’œuvre entre entreprises si la société utilisatrice, cliente de la société fournissant le salarié pour la prestation de services, rembourse à cette dernière tous les salaires et charges sociales dudit salarié concernant sa mission au sein de l’entreprise (Cass. Soc., 7 décembre 2016, n°15-17873 ; Cass. Soc., 18 mai 2011, n°09-69.175).
Dans quel cadre le délit de marchandage peut-il avoir lieu ?
La sous-traitance et l’externalisation sont de plus en plus utilisés par de nombreuses entreprises. C’est souvent dans ce cadre qu’un délit de marchandage peut avoir lieu.
Le principal avantage pour une entreprise est de pouvoir se focaliser sur son coeur de métier en déléguant des domaines particuliers à un spécialiste extérieur.
Par exemple de nombreuses entreprises font appel à des cabinets de recrutement afin de réinvestir leur temps gagné pour d’autres choses.
- L’externalisation d’une activité par une entreprise peut prendre deux formes contractuelles : un contrat de sous-traitance ou un contrat de prestations de services.
- La sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise (le donneur d’ordre) confie à une autre entreprise (le sous-traitant) la tâche de réaliser pour elle une partie des actes de production et/ou de services dont elle demeure responsable. Toutes deux vont conclure un accord pour prestation de service.
La prestation de services et la sous-traitance sont des contrats risqués.
En effet, certaines manoeuvres peuvent entraîner la caractérisation de délit pénal tel que le délit de marchandage.
N’hésitez pas à télécharger l’ebook sur comment gérer les risques liés à la collaboration avec des freelances.
Vous êtes à la recherche d’un ingénieur ou talent tech pour renforcer votre équipe ?
Kicklox vous aide à mobiliser des compétences techniques au sein de votre équipe grâce à une communauté de plus de 65 000 ingénieurs et talents tech français.
Grâce à Kicklox Services, intégrez un freelance dans votre équipe ou recruter un CDI en quelques jours.
Plus d’infos sur notre site kicklox.com.